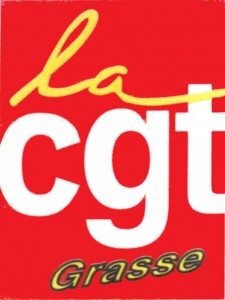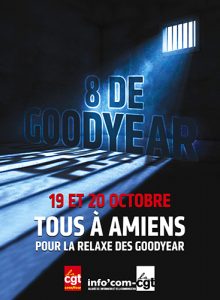La commission des Finances du Sénat français dresse un bilan plus que mitigé du crédit d’impôt compétitivité-emploi (CICE) et appelle à revoir profondément ce dispositif, dans un rapport rendu public ce mardi par Marie-France Beaufils, sénatrice communiste d’Indre-et-Loire et auteure de ce rapport.
En vigueur depuis janvier 2013, ce crédit d’impôt, conçu comme un moyen d’abaisser le coût du travail, correspond à 6% de la masse salariale des entreprises, pour les rémunérations inférieures à 2,5 smic.
Cette mesure phare du quinquennat de François Hollande, qui visait à améliorer la compétitivité de l’industrie française et à favoriser les embauches, a été fondue dans le pacte de responsabilité. Intitulé « CICE : le rendez-vous manqué de la compétitivité ? », ce rapport décrit cette mesure comme un « véritable saupoudrage », dont la forme laisse à désirer et qui, sur le fond, n’a pas encore démontré son efficacité.
Il s’agit d’ »un dispositif complexe et dispersé, à l’efficacité incertaine », a souligné Marie-France Beaufils, sénatrice communiste d’Indre-et-Loire et auteure de ce rapport, lors d’une conférence de presse mardi. Complexe à la fois pour l’Etat en termes de pilotage budgétaire, pour les entreprises, en particulier les TPE et PME mais aussi pour les services fiscaux en raison de la masse de déclarations à gérer, cet outil semble en effet ne pas avoir atteint ses objectifs.
« DES RÉSULTATS EN TERME D’EMPLOIS PAS AU RENDEZ-VOUS »
En drainant 19,4% de la créance, l’industrie est « péniblement le premier secteur concerné » par les retombées du CICE alors qu’elle représentait la cible initiale de ce dispositif. Sur le plan de la compétitivité, le résultat n’apparaît pas plus concluant, avec une nette concentration des retombées du CICE sur les entreprises non soumises à la concurrence internationale.
Les entreprises réalisant moins de 10% de leur chiffre d’affaires à l’exportation reçoivent près de 80% de la créance. Outre ces bénéfices incertains en matière de compétitivité, les conséquences du CICE en termes de créations d’emplois s’annoncent bien moindres qu’espéré et « il est à craindre que les résultats ne soient pas au rendez-vous », a dit Marie-France Beaufils.
Faute de données précises disponibles pour l’heure sur ce point, elle a repris dans son rapport une estimation publiée par l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) en décembre dernier, qui indique que le CICE avait permis de maintenir 125.000 emplois. Ce constat soulève d’autant plus d’interrogations que les sommes engagées sont loin d’être négligeables : 20 milliards d’euros chaque année, soit environ 35% des recettes brutes de l’impôt sur les sociétés ou encore 1% du PIB.
REVOIR TOUT LE DISPOSITIF
Pour Marie-France Beaufils, cela conduit donc à se poser la question suivante : « Si ces 20 milliards avaient été injectés directement dans de l’investissement décidé par le budget de l’Etat, n’aurait-on pas été plus efficace ? » D’autant plus, souligne-t-elle, que lorsqu’on cumule les 20 milliards dégagés chaque année, « on obtient une masse totale qui est énorme.
» L’une des recommandations de son rapport, qui pointe également les lacunes du suivi et du contrôle du recours à ce crédit d’impôt, est donc de « revoir profondément dans sa forme comme dans son montant, le dispositif complexe et budgétairement qu’est le CICE ». Elle préconise par ailleurs un redéploiement des fonds correspondants « dans des plans d’investissements en faveur des infrastructures et de la transition énergétique. »